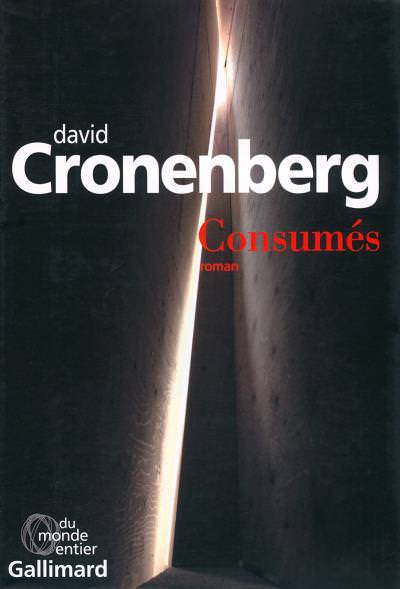8

8
David Cronenberg tells us everything about his first novel “Consumed”
Cinéaste mythique, David Cronenberg vient de signer son premier roman, “Consumés”. Sexe, pulsion de mort, fantasmes high-tech, fusion de l’organique et du technologique… Il a raconté à Numéro la genèse de son ouvrage.
Numéro : Quand vous est venue l’idée de Consumés ?
David Cronenberg : Tout a commencé avec un scénario. J’avais imaginé une histoire dans laquelle figurait un couple mythique d’intellectuels français. La femme du philosophe, elle-même philosophe, semblait avoir été assassinée, et un couple de jeunes journalistes nord-américains décidait de mener l’enquête. Et puis, ça s’est arrêté là. Parfois les choses meurent, c’est mystérieux. Rétrospectivement, j’aime à penser que j’avais alors conscience qu’un film n’aurait pas pu contenir le sujet, et que seule une forme romanesque pouvait tenir la promesse de sa complexité narrative. Ce qui est vrai, c’est que le roman offre un espace formidable en termes de finesse psychologique et de réflexion.
Quelque chose vous a-t-il poussé à franchir le cap de la fiction ?
Oui, un coup de fil de Nicole Winstanley, de la maison d’édition Penguin Canada. Elle m’a dit : “J’ai vu tous vos films, lu tous vos scénarios, je crois très sincèrement que vous devriez écrire un roman. Y avez-vous déjà songé ?” “Seulement depuis une cinquantaine d’années”, ai-je répondu. En fait j’avais toujours cru que je serais un écrivain. Mon père était journaliste et auteur, notre maison était pleine de bouquins et, enfant, je m’endormais au son de sa machine à écrire. Alors l’idée d’écrire était loin de m’être étrangère.
Alors pourquoi avoir choisi le cinéma ?
J’étudiais à l’université de Toronto, c’étaient les années 60, l’avant-garde new-yorkaise avec Kenneth Anger, Andy Warhol, chacun pouvait prendre une caméra, faire ses propres images, sans passer par une quelconque école ou Hollywood. La technique m’intriguait également : comment synchronise-t-on le son et l’image ? Aujourd’hui les gens qui filment avec leur iPhone n’y réfléchissent pas, c’est automatique, mais au cinéma, non. J’étais très curieux. Je me suis littéralement précipité sur l’Encyclopædia Britannica, où je me suis plongé dans les entrées “caméra” et “objectif”. Puis je me suis abonné au magazine American Cinematographer, le journal des réalisateurs et des chefs opérateurs de Hollywood. C’était enivrant, je ne savais rien du cinéma.
Quelle est pour vous la différence entre l’écriture d’un scénario et celle d’un roman ?
Bien que j’aie écrit beaucoup de scénarios, ma conversion au roman a été un très long processus. L’écriture scénaristique est très différente de l’écriture romanesque. Le scénario est une manière d’écrire hybride, bizarre. Personne ne vous complimentera s’il y a du style, au contraire, on vous fera le reproche d’être trop littéraire en vous traitant de romancier frustré qui ignore les règles élémentaires du scénario. Dans un scénario, pourquoi dépeindre le protagoniste en long et en large puisque de toute façon on castera Tom Cruise ou une autre star qui ne collera pas avec la description de votre personnage. Pour un bon scénario, il faut de bons dialogues et un certain sens de la dramaturgie. Pour le reste, oubliez la musique des mots, les belles phrases. Plein de scénaristes réputés sont totalement nuls en grammaire ou stylistiquement, cela ne les empêche pas d’être de grands scénaristes. Le scénario subit, du reste, une pression de plus en plus forte. C’est le duel “commercial” contre “art et essai”. Les choses ne vont pas en s’arrangeant. Je crois qu’aujourd’hui, à cause du financement, il est très difficile de réaliser un film original ou subversif. C’est une contrainte supplémentaire dont doit tenir compte le scénariste.
Votre livre sitôt publié, on vous a demandé si vous ne voudriez pas l’adapter au grand écran… Ce à quoi vous avez immédiatement répondu non. Pourquoi ?
Quand j’ai été invité à adapter The Fly [La Mouche] par le théâtre du Châtelet, on m’a tout de suite proposé de mettre à ma disposition des écrans vidéo et tutti quanti. J’avais refusé en bloc. Je voulais en effet une pure expérience de mise en scène. Les images, je connaissais, ce que je voulais, c’était de la musique, de la chorégraphie… Le même raisonnement s’applique à mon livre. Consumés n’est pas le pis-aller d’un film, il n’a pas besoin d’une caméra pour le valider. Cela dit, cinq ou six producteurs m’ont déjà approché pour me proposer d’adapter Consumés au cinéma, et même pour une série TV. Mais là je raisonne en romancier qui serait ravi qu’on achète l’option et les droits de son livre : donnez-moi l’argent et j’irai à l’avant-première.
Un personnage de Consumés note que tel autre prononce “migraine” à l’anglaise et non à l’américaine. Dans ce roman, on goûte vraiment votre sens du détail !
Cela passerait sans doute inaperçu dans un film, ou le public américain ne serait pas susceptible de comprendre les subtilités sociologiques liées à de tels détails. Dans la fiction, on peut creuser. Cette description en profondeur, c’est le génie du roman, cette gamme infinie de nuances, qu’elles soient physiques, psychologiques ou techniques.
Et cette façon de traduire le temps…
Oui, le traitement subjectif du temps est un des avantages de la fiction, traduire cette intériorité du temps, cette façon qu’il a de fluctuer au gré des pensées et des actions des personnages, le cinéma ne peut guère le faire, sauf à être extrêmement lourd ou maniéré, ce qui devient fort dommageable à la dynamique du film. À moins de faire un film expérimental sur le temps, en tant que réalisateur, on l’évite. Dans les films narratifs classiques, les strates temporelles sont translucides et ne se ressentent pas. La supériorité du livre tient aussi au fait que sans le formatage du cinéma – tous mes films font moins de deux heures, une efficacité dont je ne me plains pas –, on a justement le temps, on peut construire des personnages de manière très lente et subtile. C’est l’art délicieux du roman : vous pouvez vous déployer et le lecteur ne vous en veut même pas ! Il ne sera pas en train de regarder sa montre toutes les cinq minutes en vous lisant.
Quelles sont ou ont été vos influences littéraires ?
J’ai eu différentes périodes. Nabokov, beaucoup, et très certainement William Burroughs. Deux écrivains on ne peut plus différents mais que j’admire profondément. Si j’ai été réticent à me lancer dans le roman quand j’étais jeune, c’est justement à cause de cette admiration pour les grands auteurs, j’avais l’impression de faire des pastiches de Nabokov sans être Nabokov, d’être toujours pseudo-quelque chose. C’est l’une des raisons pour lesquelles j’ai bifurqué vers le cinéma. Je n’y connaissais pas grand-chose et ne subissais aucune influence. Contrairement à un Brian De Palma qui rend perpétuellement hommage à Hitchcock, il n’y avait personne pour me mettre la pression. Le fait de m’être mis tardivement à la fiction m’a permis une certaine distance. Entre-temps, j’ai lu et absorbé tant d’auteurs que je ne saurais vous dire par qui je suis influencé lorsque j’écris. Quand on remarque que tel passage fait penser à David Foster Wallace, par exemple, je suis flatté, mais là n’est pas le propos, et la question des influences n’est pas intéressante pour le lecteur.
Pourquoi Paris, et ce couple d’intellectuels français ?
Évidemment, Sartre et Beauvoir ont été les modèles, transposés à notre époque. Aristide [le philosophe de Consumés] est un mélange de Sartre et de Dominique Strauss-Kahn parce que, à vrai dire, Sartre, bien qu’il ait eu des maîtresses, n’était ni sexy ni très sexuel. Je voulais un jouisseur, aussi s’il devait y avoir une adaptation cinématographique, je prendrais Dominique Strauss-Kahn pour le rôle. Pourquoi des Français ? Car outre-Atlantique un intellectuel qui soit à la fois un écrivain respecté, un homme public engagé et une vraie célébrité n’existe pas. Situer l’intrigue à Paris me permettait aussi de comparer et de jouer sur les attitudes et les différences entre la vieille Europe et le Nouveau Monde. C’est le côté Henry James du roman.
Il y a aussi ce chirurgien hongrois de Budapest qui fait des expériences et teste les possibilités du corps humain. Le “transhumain”, la fusion entre le technologique et le biologique, semble être un leitmotiv dans votre œuvre.
La biologie cellulaire, le vieillissement… Je ne fais que refléter les préoccupations du moment, ce qu’on lit dans la presse ou sur la Toile. Mais “fusion” est le bon terme, car contrairement à l’idée que l’on se faisait de la science dans les romans d’anticipation des années 50, où la technologie venait de l’espace et était toujours figurée de manière menaçante, je crois qu’aujourd’hui science et vie ne font qu’un. Je lisais l’autre jour un article passionnant sur les arbres qui mutent en fonction des insectes qui les attaquent. De la même manière, nous autres humains luttons contre les maladies et le vieillissement, non seulement grâce à notre organisme mais aussi avec les armes de la science. Il est absurde d’opposer l’organique au technologique.
Allez-vous écrire un second roman ?
J’ai commencé. Je n’ai pas de film en vue, mon prochain projet est purement littéraire.
Consumés de David Cronenberg, traduit de l’anglais par Clélia Laventure, éd. Gallimard, coll. “Du monde entier”, 384 p.