
25

25
Apichatpong Weerasethakul fait danser les fantômes à Villeurbanne
Alors que son huitième long-métrage Memoria, après avoir conquis le jury du dernier Festival de Cannes, arrive bientôt en salle, Apichatpong Weerasethakul fait l’objet jusqu’au 28 novembre d’une exposition remarquable à l’IAC de Villeurbanne. Loin d’une filmographie exhaustive, celle-ci nous immerge dans l’univers riche et poétique du cinéaste thaïlandais à travers de nombreuses vidéos et courts-métrages jamais dévoilés, peuplés d’ombres rassurantes, d’animaux divins et d’étoiles éblouissantes… entre le sommeil et l’éveil.
Par Matthieu Jacquet.
Rétrospective filmographique, séance de projections ou exposition immersive ? Difficile de savoir ce que l’on découvrira en passant la porte de l’exposition d’Apichatpong Weerasethakul à l’IAC de Villeurbanne. L’immense image qui habillera jusqu’à la fin de l’automne la façade du centre d’art pourrait en donner un premier indice : dos à un ciel bleuté crépusculaire, la silhouette à contre-jour d’un jeune homme s’éclaire des guirlandes colorées qu’il porte sur son torse. De la même manière que cet individu semble dévoiler, tel une voûte céleste parsemée d’étoiles, la richesse du monde qui réside en lui, le cinéaste thaïlandais invite le public à parcourir les nombreux recoins de son propre imaginaire. Connu et célébré depuis trois décennies pour ses longs-métrages tels que Blissfully Yours, Tropical Malady ou Oncle Boonmee, celui qui se souvient de ses vies antérieures (Palme d’or en 2010), le quinquagénaire a choisi ici de prendre le contre-pied des attentes en présentant de nombreuses créations jusqu’alors restées dans l’ombre. Photographies, installations et vidéos expérimentales – parfois de très courte durée – composent une déambulation dans sa poésie visuelle contemplative, nourrie aussi bien par la mémoire politique et spirite de son pays (dans lesquels ses projets sont presque toujours tournés) que par le rapport de l’humain à la nature, l’amour, la maladie et la mort. Ici, on croisera animaux fugaces, ombres filantes, boules de feu, et surtout de nombreux visages assoupis et corps alanguis qui – comme l’indique le titre de l’événement – peuplent la “périphérie de la nuit”.

Recroquevillés dans un coin de mur rougeoyant, les premiers protagonistes filmés de l’exposition s’endorment dos au visiteur : baignés par cette lumière ardente, ces adolescents du village thaïlandais de Nabua, à la frontière du Laos, portent en eux la mémoire d’une région traversée par les conflits entre le gouvernement et la population et s’en protègent dans un abri fictif. À leur somnolence répond l’insomnie d’une femme plus âgée quelques salles plus loin. Au cœur de la jungle, encerclé de tentures trompe-l’œil et de plantes tropicales, son lit devient l’âtre de ses doutes et de sa solitude, peu à peu brûlé par une flamme qu’elle accueille avec sérénité. Tel un marchand de sable, Apichatpong Weerasethakul contrôle le sommeil, l’éveil et leurs moments intermédiaires, propices à une réflexion profonde, faisant de la nuit la véritable toile de fond de son exposition. Pour les vivants, elle est le berceau de la créativité, du rêve et de la lutte : dans le film Ashes (2012), le spectacle fugace de poteaux électriques en pleine explosion et d’individus mouvants lors d’une manifestation reflète l’énergie simultanée de la fête et de la révolte. Mais elle est aussi le royaume silencieux des morts, dont les esprits s’éveillent et raniment les lieux jadis foulés par leurs pas. Filmé de nuit par le cinéaste, un parc de sculptures en pierre révèle par éclats de flashs et feux d’artifice les silhouettes de chiens hurlants et les visages de squelettes grimaçants, jusqu’alors immobiles et invisibles dans la pénombre.
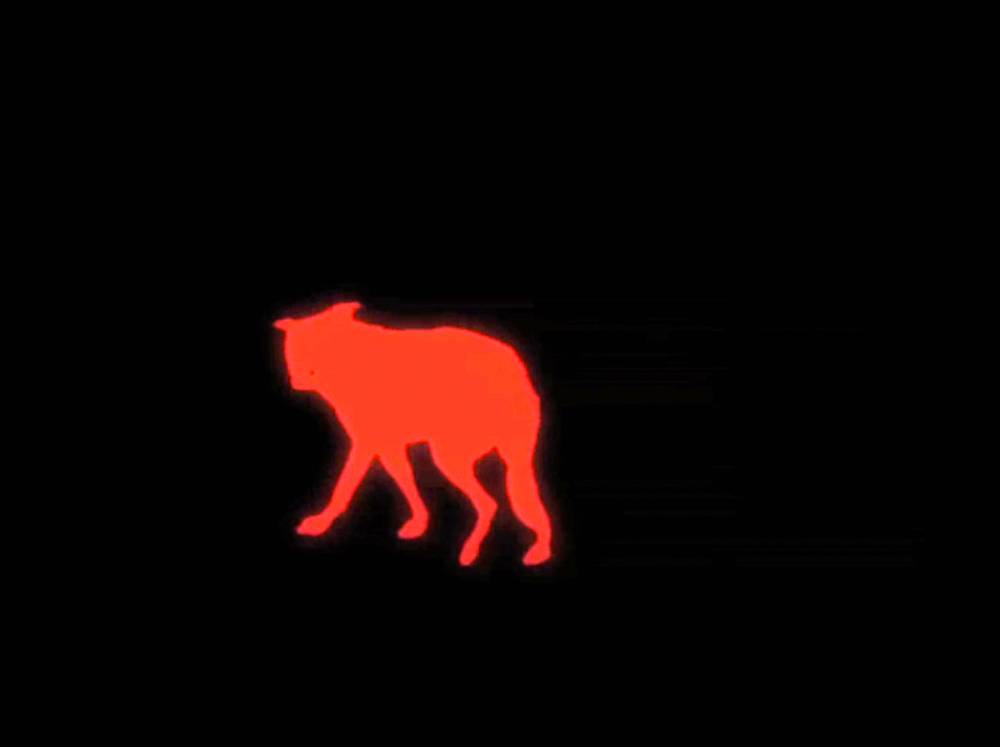
Dans une salle du centre d’art, les silhouettes d’un soldat et d’une femme à l’hôpital se répondent en diptyque comme des ombres chinoises. Dans une autre, la main qui remplit les pages d’un cahier et les néons assaillis de papillons nocturnes apparaissent sur un écran suspendu, dont le vidéoprojecteur diffuse l’image jusqu’au sol. Tantôt, le corps du spectateur passant devant la lumière se mêle à ceux de ces acteurs invisibles, tantôt, il devient à son tour un support de projection. Apichatpong Weerasethakul relève ici un défi ambitieux : continuer à captiver son auditoire en passant des salles de cinéma à celles d’exposition. Prolifique, le cinéaste réussit ce tour de force en jouant avec les supports – diapositives, écrans circulaires, doubles écrans, petits et grands formats – et en préférant exposer, plutôt que ses longs-métrages, des expérimentations et très courts-métrages pour y immerger son public mouvant. Il faudra arriver à la moitié du parcours pour découvrir, dans l’une de ses vidéos, une mise en abîme du cinéma lui-même. Au fond d’un jardin en pleine nuit, un film vient d’être diffusé sur un écran blanc, qu’une bande de jeunes hommes finissent par détruire peu à peu en shootant dans un ballon de football enflammé. Réel ou fiction ? Peu importe : l’image se consume devant les yeux du public pour laisser place à la vie.

Si Apichatpong Weerasethakul fait parler les fantômes, ceux que le cinéaste thaïlandais convoque tout au long de l’exposition n’ont rien de menaçant. Brumeux, éblouissants ou incandescents, ils interviennent comme des présences rassurantes, incitant à se déplacer comme dans un rêve éveillé : des chiens rouges évanescents projetés aux murs indiquent le chemin, la tête d’un singe figée dans la pierre rassure par son aura divine, pendant que des défunts se changent en étoiles pour éteindre la peur des ténèbres. À un cinéma contemporain souvent bavard, l’artiste oppose une exposition muette peuplée de ces présences évanescentes, où triomphent le silence et le sensoriel. Dévoilé cet été à Cannes, son nouveau long-métrage Memoria y est évoqué par un diptyque inédit où Tilda Swinton, sa tête d’affiche, paraît elle aussi fantomatique, allongée sur un lit dans une atmosphère bleutée. Immobile et insomniaque, l’actrice fétiche du cinéaste voit le soleil se lever pendant que des vues d’une ville à l’aube ou d’individus assoupis se succèdent à sa droite, telles les images qui défilent dans son esprit travaillé par la recherche d’un mystérieux souvenir. Enfin, comme une évidence, l’exposition baisse son rideau au plus près du visage endormi de l’ancien amant d’Apichatpong Weerasethakul, décuplé sur trois écrans verticaux. Alors, la persistante obscurité des films précédents laisse place à l’empreinte lumineuse d’un amour déchu, saisi à son aube par l’objectif intimiste d’un smartphone. Sans un mot, l’artiste parvient à convaincre : le cinéma est bel et bien un moyen de capturer ses propres fantômes. Après tout, cette longue nuit pourrait bien avoir, à son tour, transformé le spectateur en spectre.
Apichatpong Weerasethakul, “Periphery of the Night”, jusqu’au 28 novembre à l’IAC, Villeurbanne.
























